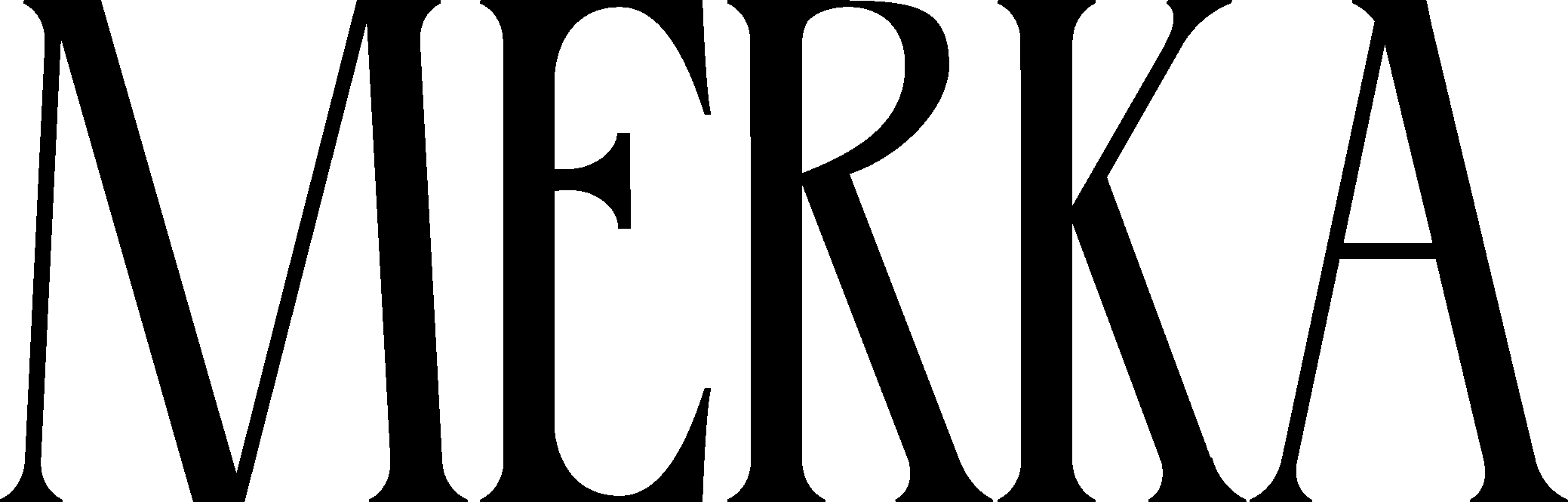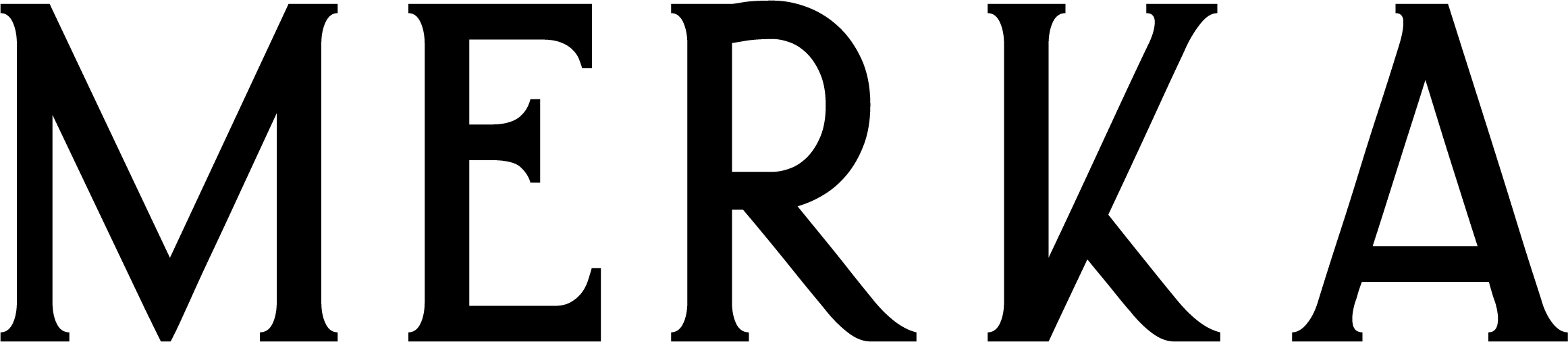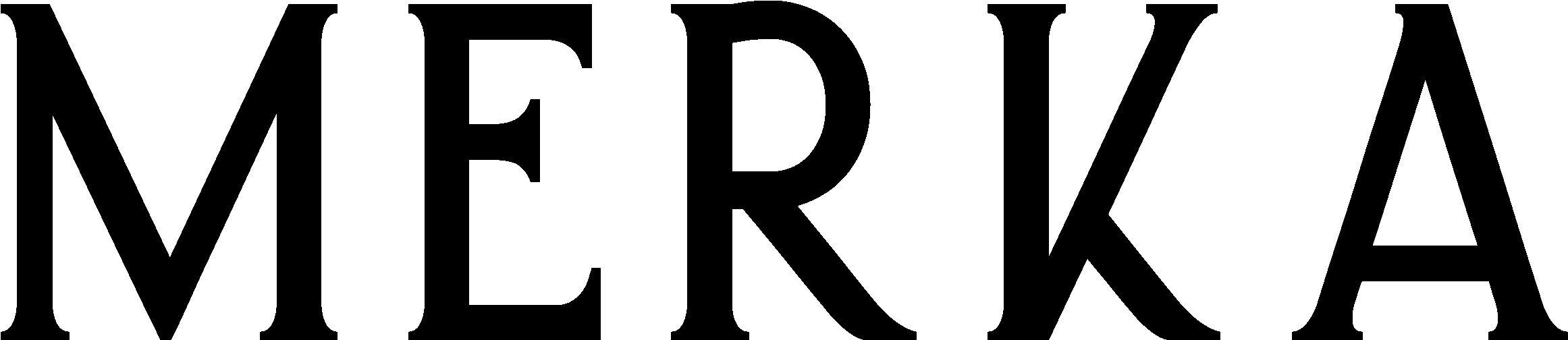Chapitre 1.1 — Ce quelqu’un que je ne vois pas
Chaque matin, entre 7h50 et 8h, je m’ouvre au rythme parisien. Lovée dans mes coussins, la tête en l’air, je pense déjà aux multiples cadences, aux pas de danses que j’épouserai pour laisser les gens se croiser, se décroiser, s’entrechasser jusqu’à mon lieu de tournage. La respiration de l’homme que j’aime se glisse contre la mienne, chaude et humble, pour siffler le départ de la journée. Je me suis levée sur la pointe des pieds, par tendresse, ou peut-être parce que mes pensées étaient trop fragiles pour être partagées si tôt. Le café met quelques secondes à couler, nos deux tasses sont alignées sur le comptoir : la sienne, simple, la mienne, cabossée par l’usage et fidèle comme une amie.
Il dort encore, et mon retard est déjà consommé. Les pieds ne sont plus sur les pointes, je dois trouver comment m’habiller. Robe-qui-cache-le-retard ? Pull de la veille, parfum du jour ? Cheveux en bataille mi-défaite, mi-déterminée ? Il me reste 1 minute avant de perdre la réservation de mon Lime, tant pis. J’enfile la vérité la plus féminine du XXIème siècle, « mon rouge à lèvres fera le travail ».
Pressée de rejoindre Paris, je claque la porte derrière moi avec l’élan de quelqu’un qui a déjà 20 minutes de retard sur sa propre vie. À peine ai-je posé le pied sur le palier que je tombe sur Magnus, mon voisin du 4ème, embarqué malgré lui dans des situations qui dépassent son calme naturel.
Il est planté devant la loge de Mme Boulanger, notre concierge, une femme minuscule mais dont l’autorité dépasse les murs de l’immeuble.
Magnus tient dans ses mains une plante verte agonisante.
— Je pense que la plante a subi un choc existentiel.
— Un choc ?
— Oui. La lumière d’hiver. La crise du sens. L’angoisse de l’avenir.
— Monsieur Magnus, c’est une fougère, pas un étudiant en philosophie.
Je me glisse dans la scène, amusée.
— Ou alors elle a simplement manqué d’eau, dis-je.
— Pauline, soupire-t-il, tu réduis toute poésie à la pratique.
La concierge, triomphante :
— Merci, mademoiselle. Une femme de terrain, enfin.
Magnus est une âme douce dans un monde trop bruyant. Un homme qu’on aime chambrer, parce qu’il ne se défend jamais vraiment, sauf quand il s’agit de débattre de Godard ou du meilleur beurre pour les tartines.
Il remet sa fougère sous le bras, résigné, et me glisse en passant :
— Tu pars sauver Paris ?
— Non, juste essayer de ne pas me faire avaler par elle.
— Bonne chance, dit-il. Elle a faim, ce matin.
— Je passe te voir ce soir. Et garde-moi la chemise et les mules avec les coeurs en métal Prada 2000’s trouvées chez Grain de Sell, j’ai besoin d’un miracle visuel pour mon prochain shooting.
Je descends la rue d’un pas rapide, mon retard me tirant par le poignet. En approchant de la Porte de Clichy, la ville change d’épaisseur, les bus s’énervent, les klaxons s’impatientent, les silhouettes se croiser en flèches tirées dans tous les sens. Je ressers mon manteau et m’approche de la bouche de métro.
C’est exactement là, que la sensation revient. Je me souviens alors d’un article que j’avais écrit, il y a quelques mois de ça, pour la chronique philo de mon magazine de mode préféré. J’y évoquais les Pintupi, ce peuple du désert australien pour qui la peur est une matière découpée en 15 nuances. À cet instant, le monde se rapproche en Kamarrarringu, sentiment glaçant, tendu, que quelqu’un se faufile derrière moi sans bruit. L’air venait de s’ouvrir pour laisser passer quelqu’un. Je ralentis. Mon coeur, lui, accélère. Une intuition, presque animale : quelqu’un suit mes pas à un rythme trop proche du mien pour un simple hasard. Je tourne la tête, discrètement, en feignant de vérifier je ne sais quoi sur mon téléphone. Personne. Personne de distinct en tout cas. Juste une marée de passants pressés, des sacs qui claquent, un joggeur qui slalome et un chien qui promène son maître. Et pourtant, la sensation persiste.
Je dépasse la bouche de métro, et la foule se disperse juste assez pour que je jette un regard par-dessus mon épaule. Une silhouette. Floue. Vite avalée par les flux humains. Trop vite. Comme si elle m’avait vue me retourner et avait immédiatement décidé de disparaître.
Je reste un instant les yeux rivés sur la grille de métro qui souffle son haleine métallique, et je murmure pour moi-même, presque par réflexe :
« Ce n’est rien… ou c’est quelqu’un. »
Je ne suis plus seule. Ce matin, Kamarrarringu m’a choisi. Et quelque chose, désormais, attend derrière moi.